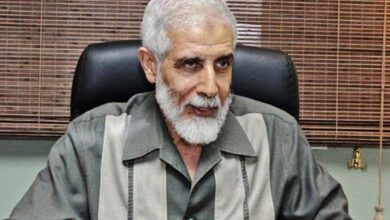La génération Z, des Andes à l’Himalaya : des voix sans leader sous la bannière du crâne

Des montagnes des Andes à celles de l’Himalaya, une nouvelle vague de protestations émerge, portée par une jeunesse qui exprime son ras-le-bol face à la réalité politique et sociale.
À Madagascar, le président Andry Rajoelina a été contraint de quitter le pouvoir et de quitter le pays après un « coup d’État militaire », survenu à la suite de semaines de manifestations menées par des jeunes se présentant comme la « Génération Z Madagascar ». Ces derniers protestaient contre les coupures d’eau et d’électricité, avant que le mouvement ne prenne une tournure politique plus large.
-
Madagascar en crise : une unité militaire rebelle annonce la prise de contrôle de l’armée
-
Daech cherche à relier ses foyers de propagation en Afrique : un danger qui dépasse le continent
Madagascar devient ainsi la dernière ex-colonie française où l’armée a pris le pouvoir depuis 2020, après les coups d’État survenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon et en Guinée.
Ce soulèvement dans l’île de l’océan Indien rappelle d’autres mouvements récents observés au Népal, aux Philippines, en Indonésie, au Kenya, au Pérou et au Maroc.
Un point commun relie ces protestations : la plupart sont dépourvues de leadership clair et composées principalement de jeunes se réclamant de la « génération Z », c’est-à-dire ceux nés entre 1996 et 2010, la première génération à avoir grandi entièrement à l’ère numérique.
-
Tentative de prise de pouvoir par la force : que se passe-t-il à Madagascar ?
-
Les protestations de la Génération Z à Madagascar entrent dans une nouvelle phase : signes de division au sein de l’armée
Selon Sam Nadel, directeur du Social Change Lab, une organisation britannique spécialisée dans l’étude des mouvements sociaux, « ce qui relie ces protestations menées par les jeunes, c’est un sentiment partagé d’ignorance de leurs préoccupations, qu’il s’agisse de corruption, de changement climatique ou d’inégalités économiques. La protestation devient alors la réponse naturelle lorsque les institutions ferment leurs canaux d’écoute ».
Des contextes différents, mais les mêmes frustrations
Bien que les revendications varient d’un pays à l’autre, la plupart de ces mouvements ont éclaté à la suite d’abus ou de négligences gouvernementales.
-
L’expansion d’Al-Qaïda en Afrique de l’Ouest : le Togo dévoile le bilan des attaques
-
Un rapport turc révèle l’expansion de Daech en Afrique et la montée de sa menace : que contient-il ?
Au Maroc, un groupe sans chef, baptisé « Génération Z 212 » — en référence à l’indicatif téléphonique du pays —, est descendu dans la rue pour exiger une amélioration des services publics et une augmentation des budgets alloués à la santé et à l’éducation.
Face à ces manifestations, le roi Mohammed VI a appelé, dans un discours devant le Parlement, à accélérer les réformes pour offrir davantage d’emplois aux jeunes, renforcer les services publics et accorder une attention particulière aux zones rurales.
Au Pérou, les protestations contre une loi sur les retraites se sont élargies pour inclure des demandes plus vastes, telles que la lutte contre l’insécurité croissante et la corruption généralisée au sein du gouvernement.
-
La chute d’un avion du Félin d’Afrique enflamme le nord du Mali : vers un scénario de guerre ?
-
La nourriture comme arme : comment les groupes djihadistes exploitent la famine pour étendre leur influence en Afrique
En Indonésie, des manifestations violentes ont éclaté en raison des privilèges des parlementaires et de la flambée du coût de la vie, poussant le président à remanier ses ministres clés de l’économie et de la sécurité.
Le mouvement le plus emblématique, connu sous le nom de protestations de la « Génération Z », fut celui du Népal, marqué par des affrontements sanglants ayant conduit à la démission du Premier ministre en septembre dernier.
Les manifestants se sont inspirés de soulèvements réussis ailleurs en Asie du Sud, notamment au Sri Lanka en 2022 et au Bangladesh en 2024, qui avaient entraîné la chute de leurs gouvernements.
-
Utiliser l’économie comme outil d’infiltration… Al-Qaïda s’étend en Afrique de l’Ouest
-
Comment Ag Ghali est passé de chanteur à l’un des chefs les plus dangereux d’Al-Qaïda en Afrique de l’Ouest ?
À Madagascar, les protestataires affirment s’être particulièrement inspirés des mouvements népalais et sri-lankais.
Les manifestations y ont débuté à cause des coupures d’eau et d’électricité, mais ont rapidement évolué vers des appels au départ du président et de son gouvernement.
Mercredi dernier, le chef du coup d’État a annoncé qu’il assumerait la présidence du pays.
Plus de 80 % des 32 millions d’habitants de Madagascar vivent avec moins de 15 000 ariary par jour (soit environ 3,25 dollars), en dessous du seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale.
-
L’Afrique de l’Ouest pourrait bientôt voir émerger un État jihadiste… Quelles sont les causes de son apparition ?
-
La Russie étend son influence militaire en Afrique : une menace pour les intérêts américains et britanniques via la base de Port-Soudan
Le drapeau noir et la « bannière du crâne »
Dans plusieurs pays, un symbole culturel commun est apparu : un drapeau noir représentant un crâne souriant sur deux os croisés, coiffé d’un chapeau de paille.
Ce drapeau est inspiré du célèbre manga et anime japonais One Piece, qui raconte les aventures d’un équipage de pirates affrontant des gouvernements jugés corrompus.
Au Népal, les manifestants ont hissé ce drapeau sur les portes du Singha Durbar, siège du gouvernement, et sur plusieurs ministères, dont certains ont été incendiés. La même bannière a flotté lors des protestations en Indonésie, aux Philippines, au Maroc et à Madagascar.
-
L’extinction de la dernière base… La Côte d’Ivoire approfondit les pertes de la France en Afrique
-
Événements politiques attendus en Afrique en 2025
La semaine dernière, à Lima, la capitale péruvienne, un électricien de 27 ans, David Tafur, a brandi le même drapeau sur la place San Martín, désormais épicentre des manifestations hebdomadaires.
« Pour moi, il s’agit de la colère contre les abus de pouvoir, la corruption et les morts », a-t-il déclaré, faisant référence à la montée des crimes et extorsions qui ravagent le pays depuis 2017, alors que de nouvelles lois ont affaibli la lutte contre la criminalité.
-
Le recul de la présence française en Afrique avec la fin de la coopération en matière de défense au Sénégal et au Tchad
-
L’augmentation du risque d’évasion des terroristes des prisons en Afrique de l’Ouest : Détails
La mobilisation numérique
Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans ces mobilisations modernes. Les jeunes s’en servent pour communiquer, partager des informations et organiser leurs actions.
Avant le déclenchement des protestations au Népal, le gouvernement avait tenté d’interdire la plupart des plateformes sociales, mais les jeunes ont contourné cette mesure à l’aide de réseaux privés virtuels (VPN).
-
L’Afrique du Sud est-elle le centre financier de Daech en Afrique ?
-
Quelles sont les répercussions de la montée du terrorisme en Afrique sur l’Europe ? Un expert répond
Sur TikTok, Instagram et X, les manifestants ont dénoncé le train de vie des enfants de dirigeants, soulignant le fossé entre riches et pauvres, tout en lançant des appels à la mobilisation.
Selon Yujan Rajbandari, un manifestant népalais, « ces protestations ont permis aux jeunes de se rendre compte qu’ils sont des citoyens du monde, unis par l’espace numérique, qui représente aujourd’hui une force d’influence mondiale ».
-
Centrafrique : Des corps « sans têtes » ravivent le spectre du conflit sectaire
-
Augmentation de l’activité terroriste en Afrique : quelles conséquences et quelles solutions ?
-
La libre circulation des armes et l’infiltration des éléments terroristes ont aggravé le terrorisme en Afrique
-
Après avoir déplacé son poids vers l’Afrique, Abdulkadir Mumin, Somali, pourrait-il devenir le prochain leader de l’État islamique (ISIS) ?
-
Après 10 ans… Les États-Unis échouent face à la propagation du terrorisme en Afrique de l’Ouest