Le Soudan entre le marteau de l’armée et l’enclume des islamistes
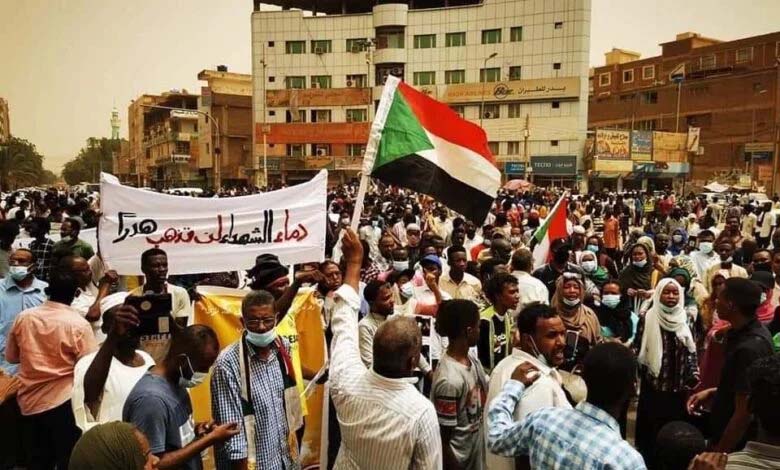
Les événements s’enchaînent au Soudan à un rythme soutenu, révélant que le conflit en cours n’est plus une simple confrontation entre l’armée et les Forces de soutien rapide, mais une scène où se règlent des comptes internes au sein de l’institution militaire elle-même. Les intérêts personnels s’y entremêlent avec d’anciennes alliances idéologiques, transformant l’avenir du pays en une monnaie d’échange entre des forces incapables de bâtir un État ou de préserver sa souveraineté.
-
L’armée soudanaise et le mouvement islamique : une alliance qui s’effondre à l’ère des marchandages
-
Le Soudan entre généraux corrompus et islamistes assoiffés de guerre
Des informations de plus en plus nombreuses font état d’accords secrets entre les Forces de soutien rapide et un courant au sein de l’armée dirigé par Abdel Fattah al-Burhan, en vue d’une solution politique visant à écarter le courant islamiste du paysage. Ce revirement soudain dans la position d’al-Burhan traduit une prise de conscience tardive : les islamistes ne sont plus un soutien, mais un fardeau qui menace sa survie. Le maintien de son alliance avec eux risquerait désormais de l’isoler sur le plan interne et de le placer sous une pression internationale accrue.
Parallèlement, des preuves s’accumulent sur l’abandon par l’armée des mouvements armés dans la ville d’Al-Fashir, laissés à leur sort sans appui militaire ni couverture politique ou logistique. Une telle attitude ne peut être comprise que dans le cadre d’une mentalité raciste profondément enracinée au sein de la hiérarchie militaire, qui continue de percevoir les composantes venues de l’Ouest comme un simple levier sacrificiel. Cette vision réduit l’État à une géographie sélective et reproduit les fractures qui ont mené à la désintégration du Soudan.
-
Le dossier secret : comment Le Caire exerce des pressions pour démanteler la mouvance islamiste au sein de l’institution militaire soudanaise ?
-
Maliṭ : le bombardement qui a révélé l’essence du projet islamiste
À Port-Soudan, où siège le pouvoir autoproclamé « légitime », un autre drame se joue. Le système de santé s’y est complètement effondré, les épidémies se propagent à un rythme alarmant, tandis que la direction militaire est accusée d’entreposer les médicaments et le matériel médical au profit de l’effort de guerre. Dans un pays rongé par les crises, le médicament est devenu une arme et les hôpitaux des otages — symbole d’un pouvoir devenu un poids mort pour la population au lieu d’un instrument de protection.
Dans ce contexte de délabrement, les accusations de corruption se multiplient contre des responsables de l’armée impliqués dans le trafic et la vente illégale de l’or soudanais, dont les profits seraient détournés à des fins personnelles avec la complicité de puissances étrangères. Ce phénomène traduit non seulement une déliquescence morale au sein des institutions, mais révèle aussi un système de guerre destiné à protéger les privilèges plutôt que la patrie.
-
La mort d’Anas Faisal à Umm Sayala : un coup dur pour le mouvement islamique et un signe de fissures dans les alliances militaires au Soudan
-
L’attaque contre le convoi humanitaire à Mellit : un nouveau crime de guerre qui révèle le visage sanglant du mouvement islamique
Sur le terrain, la situation est encore plus sombre. Les retraits successifs dans les zones de Kordofan et la chute imminente d’Al-Fashir s’accompagnent de désaccords profonds entre le commandement militaire et le mouvement islamiste quant à la conduite des opérations. L’armée, autrefois symbole d’unité nationale, s’enlise dans les divisions et perd sa cohésion, incapable de définir même son véritable ennemi.
Des sources multiples évoquent des changements imminents à la tête de l’armée, signe d’une lutte interne acharnée entre factions rivales cherchant à imposer leur domination politique et militaire. Ces tensions internes illustrent la perte de direction d’une institution désormais fragmentée, où les loyautés se négocient au gré des intérêts et des opportunités de survie politique.
-
La mort d’Anas Faisal à Umm Sayala : un coup dur pour la mouvance islamiste soudanaise
-
Islamistes et armée : une alliance qui ramène le Soudan à la case départ
Au milieu de ce chaos, des rapports indiquent que al-Burhan aurait accordé à un État voisin des concessions territoriales douloureuses concernant la délimitation des frontières maritimes et l’exploitation du port de Port-Soudan, en échange d’un soutien politique et militaire continu. Un tel acte constitue une atteinte flagrante à la
souveraineté nationale et démontre que la direction militaire est désormais prête à brader les frontières du pays pour prolonger son pouvoir.
-
Le Soudan au bord du gouffre : islamistes et armée mènent le pays vers l’inconnu
-
Le retour des islamistes au Soudan : soutien militaire et alliances régionales perturbent la transition politique
Malgré ses tentatives de se distancer du mouvement islamiste, l’influence de ce dernier au sein de l’armée demeure forte. Les dirigeants de l’ancien régime rejettent toute solution pacifique et prônent l’escalade militaire, au prix de l’épuisement des dernières ressources du pays et de l’alimentation des tensions tribales et ethniques. Obsédés par la restauration de leur autorité passée, ils sont prêts à reconstruire leur pouvoir sur les ruines du Soudan.
À cela s’ajoute la pression extérieure, notamment celle exercée par l’Égypte, accusée de faire chanter al-Burhan pour maintenir son soutien diplomatique et militaire, en le poussant à renoncer aux revendications soudanaises sur Halayeb et Shalatin et à faire preuve d’une inquiétante souplesse dans le dossier des eaux du Nil. Cette dépendance illustre la fragilité du pouvoir et sa soumission totale aux pressions étrangères.
-
Le Soudan entre le retour des islamistes et la reproduction du pouvoir militaire : Contexte et enquête politique
-
L’armée et les islamistes : une convergence d’intérêts qui menace la transition civile au Soudan
Le Soudan se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Entre une armée minée par la corruption et la dépendance, et un mouvement islamiste cherchant à reprendre le pouvoir par le chaos, l’État s’effondre et les espoirs des citoyens s’éteignent. Le conflit dépasse désormais la simple lutte pour le pouvoir : c’est une bataille pour l’identité et l’avenir du pays.
Sans un projet civil et national capable de rompre avec la logique des armes et de l’idéologie, le Soudan restera prisonnier entre une armée ayant perdu son honneur et des islamistes qui ne connaissent que le langage du sang pour exister. Alors, il ne restera du pays qu’un nom disputé sur les cartes des négociateurs.


